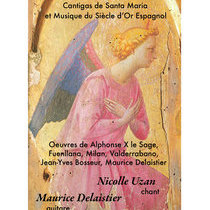RB 43 La grâce du temps bien réglé
Un long chapitre de presque vingt versets pour une vertu qui paraît mineure : la ponctualité.
Depuis longtemps, mon nom m’a prédisposé à être attentif à la ponctualité : la devise familiale, avec sa résonance médiévale : « Tardif, haste-toi ! ».
Je n’ai pas oublié non plus la petite remarque finaude d’un prof de fac qui fit rire la salle à mes dépens, il y a presque quarante ans : « Tiens ! vous êtes en retard, Monsieur Tardif ! »
La tradition nomme cette vertu mineure, la ponctualité, la « politesse des rois ».
Pourquoi ? Parce que le rapport au temps dit quelque chose d’une volonté de puissance. C’est ce que commente Simone Weil :
« L’humilité est un certain rapport de l’âme au temps. C’est une acceptation de l’attente. C’est pourquoi, socialement, la marque des inférieurs est qu’on les fait attendre. La parole du tyran est : « j’ai failli attendre ! ». Mais la cérémonie, qui fait tous les hommes égaux dans sa poésie, est attente pour tous. » (La connaissance surnaturelle)
Il y a là une clé quasiment bénédictine, notamment dans la dernière phrase : « la cérémonie, qui fait tous les hommes égaux dans sa poésie, est attente pour tous. ».
L’office, la messe, sont, par leur ritualité même, des lieux de profonde égalité à cause de ce rapport au temps qui ne permet pas à la domination, à la tyrannie, de se manifester, sauf justement à rompre la communion, à faire violence au rite, et cette violence est immédiatement perceptible.
Dans nos offices, le rythme de chacun, le tempo de chacun, est tenu de s’harmoniser à celui du chœur, faute de quoi il ne serait pas possible de chanter ensemble : le chant choral n’est possible que dans cet équilibre extraordinaire d’une abdication de chacun par rapport à sa tyrannie rythmique spontanée, abdication doublée d’un don de soi total en matière d’énergie, de présence, d’attention. Celui qui arrête de chanter parce que le tempo est trop rapide ou trop lent n’est pas humble, et il le sait, il sacrifie seulement là à un désir infantile de toute-puissance. L’homme de la communion, en renonçant à son rythme propre, met quand même toutes ses forces dans l’acte de chant. C’est ce qui fait toute la différence entre le renoncement et la démission. Celui qui renonce ne jette pas l’éponge, il ne renonce pas au chant, il renonce à lui-même.
Combien de fois dans un office, dans une journée, avons-nous l’occasion d’exercer cette humilité ! Etre l’homme important, celui qui se fait attendre, à l’office, ou dans une réunion, ou sur le lieu du travail, ou bien consentir à devenir celui qui attend les autres, comme il attend Dieu lui-même.
Saint Benoît met le repas sur le même plan que l’office.
Ce rapprochement, cette mise en équivalence lui est propre, il ne dépend là ni de Cassien, ni de la Règle du Maître.
La ritualité du repas est donc très marquée : « que tous disent ensemble ce verset, prient et s’assoient à table en même temps. » ; « que nul ne soit assez présomptueux pour prendre nourriture ou boisson avant ou après l’heure fixée. » ; et, dans ce verset, le verbe « présumer » apparaît deux fois, la première fois au sens moral, « être présomptueux », la deuxième fois au sens très concret de « prendre d’avance, prendre par soi-même ». Tout au long de la RB, on voit que la PRESOMPTION, le fait de « prendre soi-même ce qu’on a pas reçu » est une attitude contraire à l’esprit monastique. Mais ici, il ne s’agit pas seulement d’un jugement de ce type, il s’agit de l’eucharistie.
Ce verbe « présumer » præsumere, dans ce sens concret, « prendre d’avance » est dans la Vulgate celui qu’utilise saint Paul quand il décrit le triste ‘repas du Seigneur’ des Corinthiens (1Co 11,21), les agapes qui déraillent : unusquisque suam cenam præsumit ad manducandum, c’est intraduisible mais c’est très expressif, quelque chose comme « chacun se prend sa cène pour manger ».
Benoît a pris l’avertissement de saint Paul au sérieux et il propose aux moines de mener une vie vraiment eucharistique, une vie de communion qui n’est pas que de façade. A la table des moines, personne « ne se prend sa cène » de son côté, nous recevons ensemble notre repas dans l’action de grâce, et cela se manifeste. D’où l’importance du temps commun, du rassemblement visible qui est marqué comme rite.
Que nous le voulions ou non, le repas est un rite humain fondamental, inscrit en nous depuis l’enfance. Christian Duquoc écrit : « L’homme nie ou transcende l’animalité de l’acte de manger par le ‘manger ensemble’ : il partage sa nourriture… entrer dans un ordre où l’autre homme n’est pas le rival mais le frère ou l’ami ; songeons à sa fragilité dès que menace à nouveau la rareté… manger ensemble est une des formes de la réconciliation… ce processus n’a pas de terme. ».
Saint Benoît nous invite à mettre le même cœur dans le manger-ensemble que dans le chanter-ensemble, et cela suppose le dépassement d’un certain nombre de petites frustrations.
Le don d’être ensemble
Le chapitre précédent, du silence de nuit, avait montré la logique de ce rapprochement entre oratoire et réfectoire : le repas rassemble, puis les services dispersent (à commencer par la cuisine, pensons à Marthe dans l’évangile), et de nouveau, une lecture va rassembler tous les frères pour le dernier office de la journée, une fois que tous sont « réunis », positi in unum.
Les deux pôles du rassemblement, de l’unité communautaire dans notre vie, sont clairement l’oratoire et le réfectoire, les offices et les repas, avec cette réunion du soir dont nos chapitres sont l’écho, et tous ces lieux sont dans la Règle des lieux d’écoute attentive de la parole.
La parole reçue ensemble est nourrissante comme du pain, nous en vivons, selon le précepte du Deutéronome, et c’est elle qui nous rassemble.
Repensant à la scène de Marthe et Marie avec cet éclairage, nous y voyons illustré ce qu’on pourrait appeler le paradoxe de la solitude : dans le service, nous sommes à la fois seuls et dispersés (« Ma sœur me laisse seule pour faire le service ! »), pris par mille choses, comme Marthe ; dans l’écoute de la parole, nous sommes-avec, comme Marie avec Jésus, rassemblés et unifiés, du côté de ce UN seul nécessaire, dont parle Jésus.
Benoît ne dit pas qu’on ira à l’office quand on aura fini tout ce qu’on avait à faire, mais qu’on « laissera tomber tout ce qu’on avait en mains dès l’audition du signal ». Le service n’a pas de fin, il y a toujours d’excellentes choses à faire encore pour le service même des frères, qu’on soit infirmier, hôtelier, cuisinier, cellérier… l’entretien, le ménage n’ont pas de fin, et c’est pourquoi on ne peut que « laisser tomber ce qu’on a dans les mains » pour aller à l’office, sans scrupules. Sinon les services seront dans la vie même de la communauté un facteur de dispersion, a fortiori ce qu’on appelle le « travail », MON travail : la tâche humaine de transformer le monde, le travail humain est comme la création, absolument infini, il n’a de bornes que celles qu’on lui fixe arbitrairement et provisoirement.
Pour Benoît, ces bornes sont la communauté rassemblée à rythme régulier. Une famille a sans aucun doute les mêmes exigences.
Tant au repas qu’à l’office, il s’agit chaque fois du temps « d’être ensemble », le temps commun, le temps de la communion, le temps par lequel nous sommes DONNES les uns aux autres.
C’est ce qui fait tout le sérieux et l’enjeu de la ponctualité, qui n’a rien à voir avec une maniaquerie tatillonne mais avec la signification la plus profonde de notre vie. Nous sommes DONNES LES UNS AUX AUTRES et les rassemblements à l’église ou au réfectoire sont les manifestations de ce don.
Le temps qui nous est donné, nous-mêmes nous essayons de le donner, de n’en rien garder à part.
Que le temps puisse être possédé, c’est une évidence : il suffit d’observer les expressions : avoir du temps, prendre son temps, donner son temps, perdre son temps ; on dit d’ailleurs « mon temps ».
Or le temps de ma vie est un don reçu de Dieu et un don à consentir à mon tour.
La double signification du mot « présent » le dit bien : la PRESENCE (à l’office, au chapitre, au réfectoire, à telle ou telle réunion de groupe) est par excellence le présent que je fais à mes frères.
Cette équivalence du temps et du don est magnifiquement signifiée à la fin du chapitre par la parabole du cadeau de l’abbé. Le cadeau, le coup de rouge ou je ne sais quel geste, c’est maintenant ou jamais. Je ne peux en aucun cas mettre un don en réserve pour plus tard parce qu’alors il ne serait pas reçu pour ce qu’il est, il serait seulement possédé, changeant de propriétaire, mais il ne manifesterait pas l’amour.
Cette finale du chapitre nous parle de nos rassemblements communautaires : la communauté rassemblée est le DON par excellence, ce cadeau immense qui nous est fait à chacun, et que nul ne peut de soi-même se donner à soi-même ; si l’on ne saisit pas ce don au moment où il est fait, c’est-à-dire au moment des offices et des repas, il nous devient impossible de nous le procurer, rien n’y fera.
Et chaque fois que je manque à ce rassemblement, j’ébrèche aussi le cadeau des autres.
Notre rassemblement, auquel chacun coopère pour sa petite part, rend plus présente, actualise la prière de Jésus, « qu’ils soient UN », et son exaucement, le DON de l’unité.
Dans ce sens résonne bien le petit conseil spirituel que Madeleine Delbrêl se donne à elle-même dans Alcide : « Fais avec tous ce qui fait du bien à tous, plutôt que de faire mieux ce qui ne fait du bien qu’à toi ! » (Alcide, un jour où il avait le goût du sublime).
De l’urgence insensée à la patience active
D’un côté « en toute hâte », de l’autre « en traînant et lentement ». Deux indications d’un rapport au temps parfaitement subjectif. On connaît bien le goût de saint Benoît pour l’empressement, la hâte, le fait de courir ; il a sa contrepartie non moins marquée dans une patience active, la grâce d’attendre, de ne rien précipiter, de s’accorder aux plus lents, selon la sagesse de « notre père Jacob » menant ses troupeaux.
Le moine règle son temps, il en devient le maître, il n’en est pas la victime.
Je pense qu’entrer dans la grâce du temps, devenir accueillant au temps comme à un bon maître, reconnaître le présent comme une présence de Dieu et comme notre présence à Dieu, est le travail positif de libération du moine. Libération face au pouvoir et à la tyrannie que peuvent représenter un rapport au temps faux, faussé, perverti.
Je lisais cette réflexion d’un philosophe dans la Croix du 27/10 : « la vitesse est une violence non sanctionnée. Notre société s’est engagée dans une course de vitesse, qui est une course de pouvoir. »
Il existe autour de nous une prise de pouvoir technologique qui obéit au seul phénomène de l’accélération, optimisation effrénée de l’usage du temps, produire, calculer, transporter toujours plus vite, vaincre la résistance de l’espace par le temps.
Avec une contrepartie double, un diktat de l’urgence, parfaitement mensonger, et donc du stress, et une exaspération de l’impatience.
Nous expérimentons tous un jour quelque chose de la logique du stress : une sur-pression momentanée qui va se traduire immanquablement par une dé-pression corollaire, en rebond. Le « bipolaire » s’installe. L’énergie de « parade à l’urgence » dope le mental, mais quelques heures après, surgit le sentiment d’une vanité abyssale de toutes nos activités, le besoin de décompresser, qui se traduit par un abrutissement devant n’importe quoi, dans le meilleur des cas, les journaux, dans le pire la passivité totale devant n’importe quel spectacle à la télé ou sur internet.
La « bipolarité » devient l’épidémie de notre civilisation, secrétée par le rythme insensé, vide de sens, qu’est devenu le temps.
Face à cela, notre rythme monastique est un trésor inestimable, une pulsation « cordiale », un rythme d’amour ; chacune de nos convocations à l’office est l’occasion de se découvrir libre de tout lâcher, renvoyé à l’essentiel qui est de perdre son temps ensemble pour Dieu : une hymne à la présence.
Le rapport au temps est exprimé dans la RB par un verbe très intéressant : vacare, « vaquer », vaquer à telle ou telle occupation. Le mot n’a de soi ni connotation positive, ni connotation négative : on vaque « à bavarder, donnant occasion au malin », on vaque à l’oisiveté, comme on vaque à la lectio ; on vaque au Malin ou on vaque à Dieu.
Le mot signifie précisément : « être libre pour ceci ou cela, être disponible, d’où s’adonner à ». Le mot « vacances » bien sûr vient de là.
Il dit notre liberté, notre disponibilité fondamentale de moines.
Le temps n’est qu’une baudruche vide que nous sommes libres de remplir d’une façon ou d’une autre. Le grand poème de Qo 3 dit bien cela : le temps est toujours à qualifier, temps pour bâtir et temps pour démolir, il est quelque chose et son contraire, il est le contenant que nous avons à remplir, et ainsi l’expression constante de notre liberté.
Les vacances, l’idée de vacances, n’est pas très ancienne (pour nombre de salariés, cela ne commence qu’après 1936). Jusque là, il y a le sabbat, le dimanche, et l’alternance jour/nuit. L’industrie lourde a profondément changé le rapport au temps : les usines ne peuvent plus s’arrêter la nuit ; on invente les trois huit, on éclaire la nuit, et ce qui était la disponibilité du temps devient tyrannie aveugle de l’horloge :
« Mumfort avait montré dans les années 30 que c’était avant tout un rapport au temps que les premières techniques avaient changé, et que c’était par rapport à une mesure exacte du temps, exacte et généralisée, que tout le système technique avait pu se développer (la pendule et la montre) » (Jacques Ellul, Le bluff technologique, p.193)
Le rythme jour/nuit est mis à mal au profit du seul cliquetis désormais uniforme de la pendule. Ce qui était don offert à une liberté, devient un pouvoir sans limite, asservi à la production, à l’efficacité, à la rentabilité marchande. Apparaissent alors les vacances, triste salaire de notre captivité, et la retraite, qui traduit surtout le besoin de rejeter les déchets improductifs.
Le moine n’a ni vacances ni retraite parce qu’il « vaque » toute sa vie durant, il choisit de recevoir et de prendre son temps, tout son temps, comme un don gratuit : il y reconnaît le DON que Dieu lui fait, et il y exprime le don qu’il veut faire en retour.
frère David